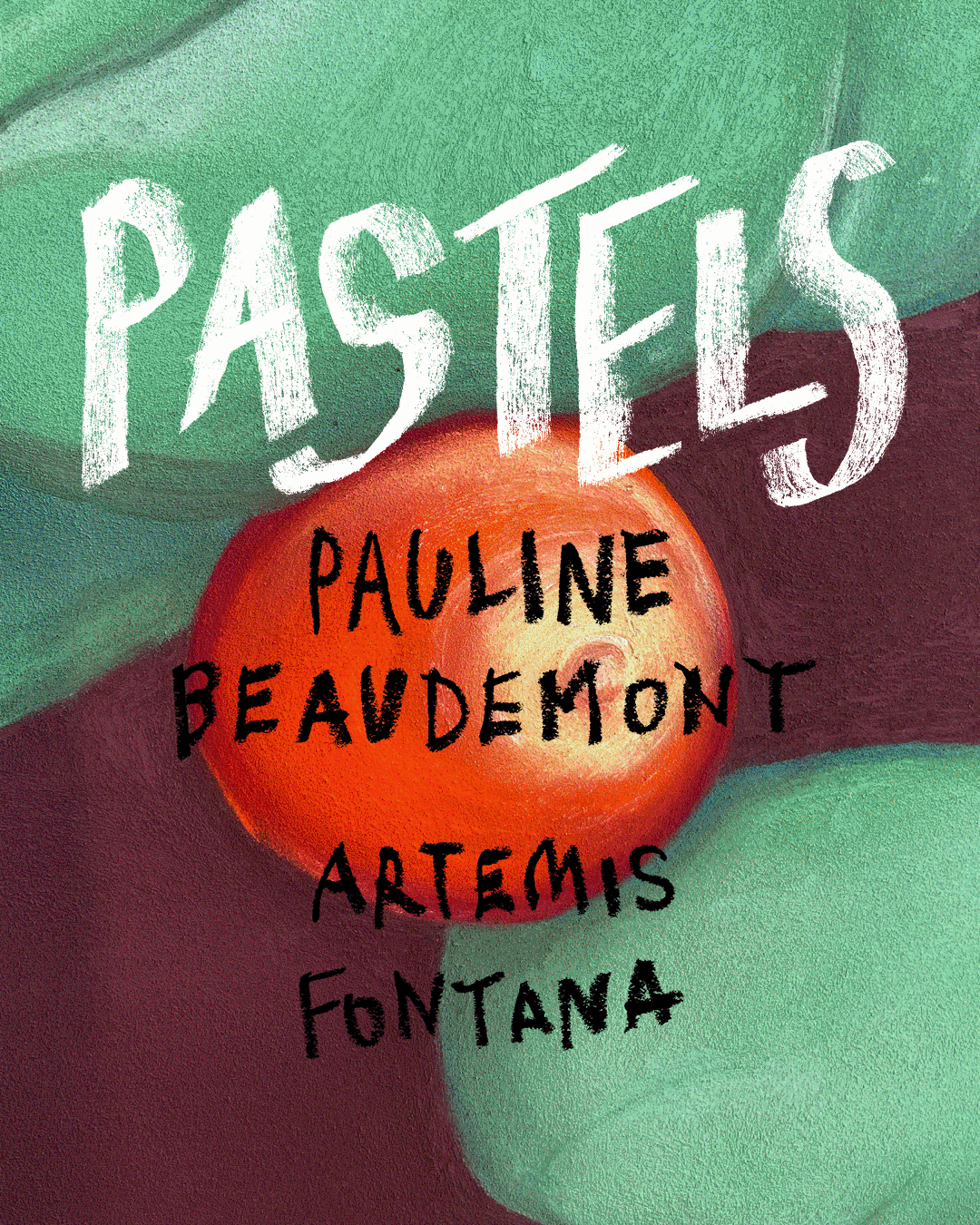











Filant la douce allégorie de l’amour et du sexe, la nouvelle série d’œuvres réalisée par Pauline Beaudemont convoque humour, sensualité, et un sens certain du grotesque. Ce sont d’abord des légumes, plus exactement des cucurbitacées, des courges, potimarrons ou butternut, un peu flasques, un peu flétries un peu vieillies mais, espérons-le, encore belles et désirables. La fascination de l’artiste pour les légumes inoffensifs semble contraster avec son penchant pour les lames et les couteaux, objets aussi attrayant que répulsifs, aussi beaux que dangereux. S’entremêlent ici couteaux japonais, à beurre, de boucher, du chef, économes, hachoirs, etc. Le couteau fait bien entendu écho à la cuisine, mais aussi à la castration, ce qui n’est peut-être pas anodin. Des éléments corporels accompagnent les cucurbitacées et les lames — ici un œil qui pleure, là-bas une dent qui se dresse, une main qui tient un fruit en équilibre ou encore une vanité, évoquant les natures mortes hollandaises ou encore le bodegón, un genre espagnol de peinture de scènes de cuisine aux XVII-XVIIIe siècles.
Ce qui frappe le regard au premier abord, c’est cette texture si particulière, au toucher velouté, du pastel sec. Pauline Beaudemont fabrique elle-même son matériel et son support, à l’aide de carton ou de toile soupoudrée de poudre de liège, une surface abrasive où le pigment se répand plus aisément. A mi-chemin entre le dessin et la peinture mais en même temps ni l’un ni l’autre, le pastel est un art singulier qui offre un rapport immédiat avec la matière. Il était considéré comme une technique de cosmétique rappelant la poudre de maquillage, évanescente et féminine, légère et frivole, pendant la Renaissance, puis c’est le XVIIIe siècle, âge d’or du pastel, qui redore son blason. Passé de mode à la Révolution, il connaît une renaissance à partir de la moitié du XIXe jusqu’au début du XXe, sous l’impulsion d’Odilon Redon notamment.
Les pastels de Pauline Beaudemont révèlent ce medium fragile et temporaire, constitué de pigments purs, et qui repose en suspension sur la surface du papier ou de la toile. La vibration qui en résulte en fait sa beauté, mais aussi sa vulnérabilité. Multiformes, les œuvres font ici fusionner ligne et couleur. C’est par une attention particulière portée à la sensation de lumière que l’artiste convoque cette qualité veloutée et mate. La lumière et l’usages de tons vifs et éclatants — vert sapin, orange, pourpre, bleu roi — semblent faire écho à la photographie commerciale des années 1970, ou peut-être la parodie-t-ils. Chez Pauline Beaudemont, qui a étudié la photographie à L’ECAL de Lausanne, les références à la photographie industrielle ou de mode, ou encore au photocollage des avant-gardes sont distillés en filigrane tout au long de sa pratique. C’est peut-être enfin le regard photographique, l’attention portée à la sensualité et au désir, et l’inspiration végétale qui semblent évoquer ici le travail de l’artiste américaine Georgia O’Keefe. De sa maison du Nouveau Mexique où elle s’est réfugiée dans les années 1930, elle décline ses motifs de paysages, de fleurs ou d’os teintés d’érotisme, en affirmant avec esprit “In a way—nobody sees a flower.”
Au début des années 1990 parut A Painter's Kitchen: Recipes from the Kitchen of Georgia O'Keeffe, un ouvrage rassemblant les recettes de cuisine de l’artiste, compilées par son assistante, et dont la plupart évoquent la cuisine hippie californienne. Plantant ses herbes aromatiques et faisant cuire son pain, O’Keefe mangeait régulièrement des produits que tout consommateur bio d’aujourd’hui considérerait comme basiques — avocats, betteraves rôties, chou kale — mais qui, pour une femme vivant dans le désert du siècle dernier, semblent profondément excentriques.
Ceux qui connaissent Pauline Beaudemont savent son appétence pour les aliments et la gastronomie, et cela au-delà de leur représentation graphique. Fine cuisinière et amatrice du faire, elle popote, fricote et reçoit avec agilité, élégance et bienveillance, autour d’une potée de légumes ou d’un gigot de Pâques. D’ailleurs, le jour où j’ai rencontré Pauline, en plein désert texan de Marfa il y a une décennie de cela, elle avait confectionné une foccacia avec le romarin du jardin. La manière dont elle tisse son rapport au monde et à sa pratique artistique nous rappelle que ce que peuvent les artistes, les femmes, et de surcroit les femmes artistes n’est pas toujours là où on les attend. Et puis que, quoi qu’on y fasse, la réalité reste plus puissante que la fiction, et la vie plus enivrante que l’art.
Martha Kirszenbaum
